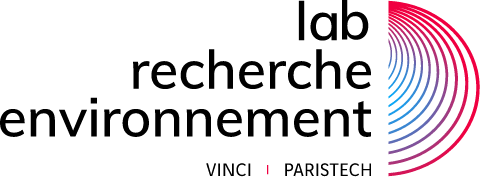Réemploi des matériaux : un indicateur pour passer du potentiel à l’action
La construction reste l’un des secteurs les plus consommateurs de ressources primaires. Pour inverser cette logique, l’économie circulaire impose une hiérarchie : réduire les besoins, réemployer les éléments existants, recycler les matériaux en fin de vie. Mais si la théorie est claire, la pratique se heurte à une difficulté majeure : comment évaluer de façon fiable la capacité réelle d’un matériau à être réemployé ?
Quel potentiel pour une seconde vie ?
 C’est cette question qu’Ambroise Lachat a explorée dans sa thèse, menée au sein du laboratoire Navier de l’École nationale des ponts et chaussées, et financée par le lab recherche environnement VINCI. « Les volumes de déchets générés par les bâtiments sont relativement bien connus, explique-t-il. En revanche, on peine encore à mesurer à quel point une poutre, une fenêtre ou un câble électrique peuvent retrouver une seconde vie». Ce constat a servi de point de départ à la construction de deux indicateurs : un indice de circularité et un indice de réemploi. Ce dernier se concentre sur un élément du bâtiment et cherche à évaluer dans quelle mesure il peut être directement réemployé, en conservant son intégrité. Conçu comme un outil d’aide à la décision, il s’adresse aussi bien aux maîtres d’ouvrage, aux diagnostiqueurs qu’aux entreprises de travaux.
C’est cette question qu’Ambroise Lachat a explorée dans sa thèse, menée au sein du laboratoire Navier de l’École nationale des ponts et chaussées, et financée par le lab recherche environnement VINCI. « Les volumes de déchets générés par les bâtiments sont relativement bien connus, explique-t-il. En revanche, on peine encore à mesurer à quel point une poutre, une fenêtre ou un câble électrique peuvent retrouver une seconde vie». Ce constat a servi de point de départ à la construction de deux indicateurs : un indice de circularité et un indice de réemploi. Ce dernier se concentre sur un élément du bâtiment et cherche à évaluer dans quelle mesure il peut être directement réemployé, en conservant son intégrité. Conçu comme un outil d’aide à la décision, il s’adresse aussi bien aux maîtres d’ouvrage, aux diagnostiqueurs qu’aux entreprises de travaux.
Le fonctionnement de l’indicateur de réemploi
La méthodologie repose sur deux grandes familles de critères :
- des critères liés à l’objet : intégrité, performance résiduelle, conformité réglementaire ;
- des critères liés au contexte : volumes disponibles, facilité de dépose, existence d’une filière, contraintes juridiques ou économiques.
« Chaque critère est noté puis pondéré, ce qui permet de générer une double lecture : d’une part, la capacité technique de l’objet à assurer encore son rôle, d’autre part, la faisabilité pratique et économique de son réemploi, éclaire Ambroise Lachat. Le résultat se traduit par un indice compris entre 0 et 1, facile à interpréter ».
Prenons l’exemple d’une porte : le premier indice vérifie qu’elle fonctionne correctement (ouverture, coupe-feu éventuel, état des paumelles…) et qu’elle est encore conforme aux normes. Le second tient compte de facteurs externes : disponibilité, facilité de dépose, existence d’une filière de réemploi. « L’idée n’est pas de calculer l’indice pour chaque composant du bâtiment, précise Ambroise Lachat, mais de cibler certains éléments clés pour aider les décideurs à arbitrer».
De l’indice à la matrice
Pour rendre l’outil plus directement exploitable, ce travail académique a été confronté à la réalité des chantiers lors d’ateliers avec les entreprises de VINCI. Ces échanges ont permis de faire émerger une version simplifiée et visuelle : la matrice de réemploi, qui cartographie les matériaux selon leur potentiel et leur disponibilité.
« L’objectif, explique Guillaume Graffin, responsable ingénierie logistique et réemploi chez VINCI Energies, est de faire ressortir les solutions les plus prometteuses, celles qui combinent un gisement significatif et une réelle faisabilité technique ».

Consolider les démarches déjà engagées
Chez VINCI Energies comme chez VINCI Construction, plusieurs filières de réemploi sont déjà identifiées et actives : câbles électriques, gaines de ventilation, sanitaires, faux planchers techniques… Souvent nées de l’intuition d’opérationnels, ces initiatives trouvent dans la matrice un moyen de confirmer et sécuriser leur potentiel. Certaines vont jusqu’à se structurer en entités dédiées. C’est le cas de Circable, au sein de VINCI Energies, qui collecte, reconditionne et remet en circulation des câbles électriques. « Avoir un pilote interne fluidifie énormément la démarche, souligne Guillaume Graffin. Cela crée un relais clair entre la déconstruction et la reconstruction, et donne une vraie continuité au matériau ».
Poser les bonnes questions
La matrice a aussi une autre vertu : elle met en lumière les contraintes concrètes que les équipes terrain ne formalisent pas toujours. « Prenons l’exemple d’une gaine de ventilation circulaire, illustre Guillaume Graffin. Neuve, elle mesure trois mètres. Mais lors d’une rénovation, sans lift ni grue, elle doit être découpée en tronçons plus courts. Pour l’installateur qui la réemploie, cela allonge le temps de pose et renchérit le coût du chantier ». L’outil montre aussi que la réemployabilité dépend fortement du contexte d’usage. « Les interrupteurs en sont un bon exemple, poursuit Guillaume Graffin. On en retrouve beaucoup lors de déconstruction d’immeubles tertiaires, mais ils ne peuvent pas être réutilisés pour ce type de programme où ils sont désormais remplacés par des détecteurs de présence. En revanche, ils peuvent parfaitement être réintégrés dans du logement, où la demande reste forte». De même, les extincteurs, dont le potentiel semble a priori intéressant, se heurtent à des freins réglementaires et assurantiels qui bloquent souvent leur réemploi.
Les « stars » du réemploi
Aujourd’hui, une dizaine de produits s’imposent déjà comme incontournables tels les sanitaires suspendus, les faux planchers, les gaines, les chemins de câbles ou les ventilo-convecteurs. D’autres, comme les briques, cloisons ou moquettes, sont encore en phase d’étude. À terme, la matrice pourrait aider à cibler une vingtaine de filières combinant acceptabilité technique, économique et environnementale.
« Pour qu’un produit trouve son marché, synthétise Guillaume Graffin, il faut réunir plusieurs conditions : un prix compétitif ou proche du neuf, un changement d’habitude minimal pour l’installateur, et une acceptabilité du client et du maître d’œuvre ». Et côté coût, si le réemploi s’avère pour le moment souvent un peu plus cher que le neuf, « il contribue fortement à la décarbonation des opérations et apporte une vraie valeur d’image », conclut l’expert.