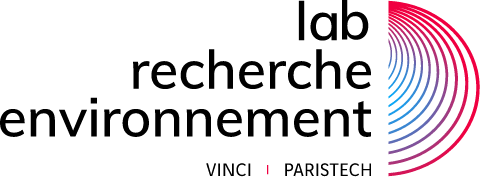Écoconception et ACV, piliers des projets urbains
Programme de recherche scientifique, collaboratif et interdisciplinaire, les travaux du lab recherche environnement visent à améliorer la performance environnementale des bâtiments, des quartiers et des infrastructures. Les trois domaines principaux de recherche sont l’efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité durable et la biodiversité urbaine et périurbaine.
Une expertise transverse relie ces trois axes : l’analyse de cycle de vie (ACV). Celle-ci permet d’évaluer les impacts environnementaux des bâtiments et des infrastructures, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur traitement en fin de vie. Dans la plupart des cas, les ACV permettent de dégager des pistes d’écoconception et de les hiérarchiser.
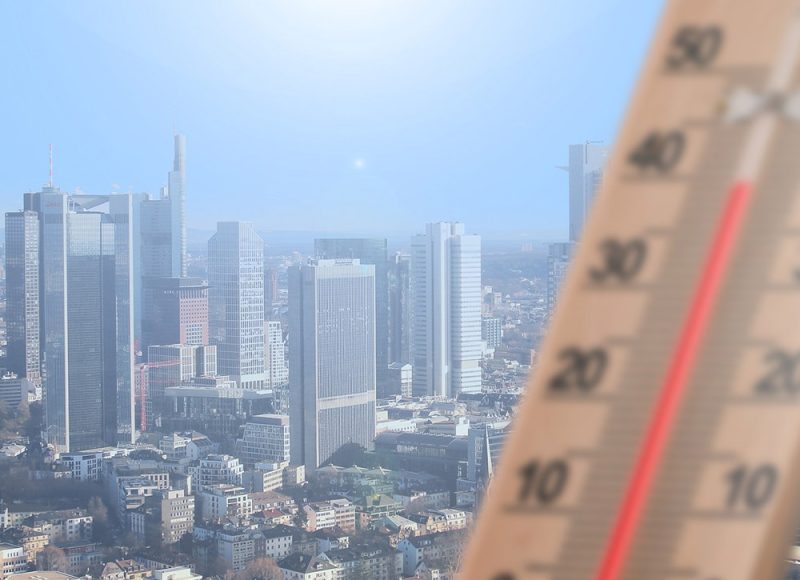 « Cela fait plus de 15 ans que nous développons des outils d’écoconception des ensembles bâtis, à l’échelle du quartier. Ces dernières années, nous avons mené des travaux sur la prise en compte des incertitudes et sur l’optimisation des projets. Nous sommes en effet désormais capables de réaliser un grand nombre de calculs à la fois, ce qui nous permet d’optimiser les projets en fonction d’un certain nombre de degrés de liberté qui s’offrent à nous. Parmi les travaux que nous avons menés sur l’évaluation environnementale, la thèse d’Aurore Wurtz a permis de coupler nos outils d’analyse de cycle de vie avec Rhino Grasshopper, un logiciel de design paramétrique fréquemment utilisé par les architectes », déclare Charlotte Roux, Enseignante chercheuse à l’école des Mines de Paris – Université Paris Sciences & Lettres.
« Cela fait plus de 15 ans que nous développons des outils d’écoconception des ensembles bâtis, à l’échelle du quartier. Ces dernières années, nous avons mené des travaux sur la prise en compte des incertitudes et sur l’optimisation des projets. Nous sommes en effet désormais capables de réaliser un grand nombre de calculs à la fois, ce qui nous permet d’optimiser les projets en fonction d’un certain nombre de degrés de liberté qui s’offrent à nous. Parmi les travaux que nous avons menés sur l’évaluation environnementale, la thèse d’Aurore Wurtz a permis de coupler nos outils d’analyse de cycle de vie avec Rhino Grasshopper, un logiciel de design paramétrique fréquemment utilisé par les architectes », déclare Charlotte Roux, Enseignante chercheuse à l’école des Mines de Paris – Université Paris Sciences & Lettres.
La qualité de l’air : un enjeu trop souvent négligé
Une autre thèse, celle de Rachna Bhoonah, a porté sur la prise en compte de la qualité de l’air dans l’analyse de cycle de vie. « Aujourd’hui, quand nous faisons de l’évaluation environnementale, nous avons une vision très globale. Nous regardons la contribution de l’énergie, des matériaux, de la consommation d’eau, à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier. Nous utilisons pour cela de grosses bases de données, mais certains aspects, comme la qualité de l’air, sont plus difficiles à apprécier parce qu’ils demandent des modélisations plus approfondies », ajoute Charlotte Roux.
Dans sa thèse, Rachna Bhoonah s’est posé la question de savoir comment optimiser l’impact total sur la santé, en incluant la qualité de l’air intérieure. Elle a notamment mis en évidence les activités des occupants d’un bâtiment qui ont un impact sur la qualité de l’air intérieur (cuisiner, allumer une bougie…), tout en intégrant les matériaux de construction utilisés qui diffusent, eux aussi, des polluants dans l’air intérieur. Elle a également tenu compte des polluants liés aux entrées d’air depuis l‘extérieur. « La vision globale qu’elle propose consiste aussi à souligner que, quand on augmente la ventilation ou quand on ouvre davantage les fenêtres, par exemple, on évacue un certain nombre de polluants, mais on augmente les besoins de chauffage. La recherche de l’optimum en matière de performance environnementale est donc une question plus complexe qu’il n’y paraît », note Charlotte Roux.
Limites planétaires et ACV absolue
Dans le cadre du nouveau programme de recherche du lab qui court jusqu’en 2028, Charlotte Roux a l’intention d’approfondir les travaux menés jusqu’à présent sur l’analyse de cycle de vie : « Dans le cadre de cette nouvelle séquence, nous sommes rentrés dans un vrai changement de paradigme. Nous sommes en effet en train d’étudier, à travers une thèse qui a commencé en décembre 2023, la question des limites planétaire et de l’ACV absolue », précise l’enseignante chercheuse.
« Avec les outils d’écoconception traditionnels, nous sommes dans une logique essentiellement comparative. Nous comparons différentes variantes, différentes possibilités techniques : faut-il installer des panneaux solaires, mettre plus ou moins d’isolant, quel système de chauffage doit-on choisir… Avec la notion d’ACV absolue, nous aimerions intégrer des seuils afin de pouvoir dire qu’un projet est – ou n’est pas – suffisamment bon en regard des limites planétaires à respecter », explique Charlotte Roux.
Cet axe de recherche va d’ailleurs impliquer les trois écoles partenaires du lab recherche environnement : « Quand vous appliquez la question des limites planétaires à l’échelle d’un quartier, les trois écoles sont concernées. L’École des Mines va travailler sur la partie bâtiment, AgroParisTech va se pencher sur la partie alimentation et l’École nationale des ponts et chaussées sur le volet lié aux transports. Grâce à ce triptyque, nous allons couvrir les trois principaux contributeurs de l’empreinte d’un citoyen français, voire européen », relate Charlotte Roux.
Les neuf limites planétaires
En 2009, une équipe internationale de chercheurs, réunie autour du Stockholm Resilience Centre (SRC), a défini neuf seuils (dont six sont déjà dépassés) au-delà desquels les équilibres naturels terrestres pourraient être déstabilisés et les conditions de vie devenir défavorables à l’humanité :
- le changement climatique ;
- l’érosion de la biodiversité ;
- la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore ;
- le changement d’usage des sols ;
- le cycle de l’eau douce ;
- l’introduction d’entités nouvelles (potentiellement toxiques) dans la biosphère ;
- l’acidification des océans ;
- l’appauvrissement de la couche d’ozone ;
- l’augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère.
Les matériaux biosourcés à l’honneur
Autre axe de travail pour les années qui viennent : les matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose…). « Les matériaux biosourcés sont de plus en plus employés dans la construction, mais il reste énormément de travail à réaliser pour consolider leur évaluation environnementale. Avec AgroParisTech, nous allons regarder les aspects liés à leur production. Avec l’École nationale des ponts et chaussées, nous allons étudier ce que l’usage de ces matériaux change dans la structure des bâtiments et des infrastructures. L’intégration de liants biosourcés dans les chaussées fera notamment partie des cas étudiés. Enfin, à l’École des Mines, nous couplerons les travaux des autres écoles avec les aspects énergétiques et environnementaux », détaille Charlotte Roux. Les travaux précités vont prendre la forme de thèses impliquant les trois écoles.
Power Road, la route productrice de chaleur
Certains thèmes de recherche sont proposés par des opérationnels au sein du groupe VINCI : « Nous essayons de faire aussi souvent que possible de la diffusion, c’est-à-dire de nous rapprocher des opérationnels et des acteurs de terrain. L’objectif est qu’ils puissent s’approprier nos travaux de recherche et appliquer les outils d’écoconception sur le terrain. En retour, cela nous permet de mieux comprendre les réalités concrètes de leur activité. C’est le cas notamment d’un projet très innovant – la route chauffante Power Road – pour lequel nous avons mené des travaux de simulation énergétique et d’analyse du cycle de vie », conclut Charlotte Roux.
Le procédé Power Road a été inventé par Eurovia, filiale de VINCI Construction, fin 2017. Il consiste à utiliser le revêtement bitumineux de la chaussée comme capteur solaire thermique. La chaleur du rayonnement solaire sur les couches de surface des chaussées en enrobé est captée, stockée, puis valorisée de différentes manières. Elle peut être utilisée immédiatement (fourniture d’eau chaude sanitaire, chauffage d’infrastructures ou de bâtiments situés aux alentours…), mais aussi en différé (Power Road est alors associé à un stockage intersaisonnier de chaleur basse température dans le sol)
Au sein du lab recherche environnement, un projet de recherche a été mené avec l’équipe Écoconception et Thermique du Bâtiment (ETB) du Centre Efficacité énergétique des Systèmes (CES) de l’École des Mines de Paris entre 2019 et 2021. Lucas Striegel, alors ingénieur de recherche, avait pour objectif de chaîner un modèle prédictif de comportement du système avec un logiciel de simulation énergétique dynamique du bâtiment (outil Pleiades Comfie). Le but recherché était d’évaluer l’intérêt d’intégrer Power Road dans la conception et la phase amont d’un projet urbain, et le cas échéant, d’optimiser le dimensionnement du système (production de chaleur, stockage, captage…) en fonction des besoins énergétiques des bâtiments avoisinants.
« Ce projet de recherche, qui s’est nourri des données issues du terrain, a permis de créer des simulations énergétiques et environnementales du système Power Road. Ces dernières facilitent le dimensionnement optimal de l’échangeur intégré à la chaussée », analyse Sandrine Vergne, Ingénieur développement technique chez Eurovia. « Par ailleurs, des analyses de cycle de vie ont été pratiquées pour quantifier les contributions de Power Road aux impacts environnementaux, le but étant de dégager des pistes d’écoconception. Lors de la phase de fonctionnement, les ACV ont montré que toutes les opérations qui intègrent Power Road, et de manière générale la géothermie, permettent de réduire les émissions de CO2 liées au chauffage et à l’eau chaude sanitaire de plus de 90 % ».

ACV : des bénéfices concrets
Enfin, dans un ouvrage collectif qu’il a coordonné, Bruno Peuportier – ancien directeur de recherche au sein du lab recherche environnement et chercheur émérite en énergétique des bâtiments à l’École des Mines Paris-PSL – a montré les bénéfices de l’usage de l’analyse de cycle de vie dès la phase de conception. Quand elle est utilisée en amont, l’ACV favorise en effet la co-construction et le dialogue entre les acteurs d’un projet, permet d’optimiser les coûts liés à la performance environnementale, mais surtout de réduire l’impact environnemental.
Dans le cadre du lab recherche environnement, les bénéfices et impacts environnementaux de deux projets menés par ADIM Lyon (filiale de VINCI Construction dédiée au développement immobilier) ont été analysés a posteriori à l’aide des outils Pleiades ACV-Equer et Pleiades Comfie.
Le premier de ces projets est le site de l’ancienne clinique Trarieux, situé au cœur d’un parc arboré du 3e arrondissement de Lyon. Il a été reconverti par ADIM Lyon et VINCI Immobilier en 91 appartements, 21 logements conventionnés, deux crèches et un EHPAD. Le deuxième projet est situé à Dijon. L’opération, développée par Adim Lyon et Nexity, a été baptisée « Terrot Town ». Il s’agit d’un projet urbain mixte de reconversion d’un ancien site industriel, celui de l’usine Terrot qui fabriquait des deux-roues motorisés.
« Ce projet a contribué à confirmer les choix réalisés par ADIM. Et pour les chercheurs, les bénéfices étaient notamment de pouvoir travailler sur des éléments très concrets. L’un des deux projets (Dijon) commençait en effet en travaux et l’autre (Lyon) avait obtenu des autorisations administratives », déclare Laurent Putzu, alors directeur d’ADIM Lyon Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.
« Sur l’opération de Dijon, nous avons été confortés sur la dimension ‘confort d’usage’. C’est un point très important pour nous. Nous avons notamment regardé en détail le confort des personnes âgées au sein de l’EHPAD qui a été construit sur le site. Par ailleurs, nous avions travaillé en amont sur cinq ou six scénarios en plan masse et volumétrie. Lors de l’analyse par les chercheurs, ces différents scénarios ont été comparés », conclut Florian Mérique, Directeur adjoint au sein de ADIM Lyon lors du projet.
Les bénéfices du travail avec le lab recherche environnement ont eu un impact direct sur l’ensemble des opérations en cours d’étude. « Suite aux travaux réalisés avec le lab recherche environnement, nous avons repensé – d’un point de vue ACV – un projet de résidence de tourisme à Serre-Chevalier. Nous avons même déposé une demande de permis de construire modificatif. Les bénéfices ont été immédiats puisque le projet a été sélectionné par La Française (vente en bloc), car il avait changé de braquet d’un point de vue environnemental », conclut Laurent Putzu.
Les travaux menés dans le cadre du lab recherche environnement illustrent l’importance croissante de l’analyse du cycle de vie dans l’optimisation environnementale des projets de bâtiments et d’infrastructures. Le recours à l’ACV permet d’établir un nouveau type de dialogue entre les différents acteurs d’un projet. Elle permet d’appuyer les choix et les recommandations et constitue une base d’échanges avec la maitrise d’ouvrage. L’ACV identifie les leviers de performances environnementales et permet d’ajuster les projets en conséquence dans une recherche d’optimum. Mais surtout, elle constitue un outil de mesure de la performance ce qui est essentiel pour réellement progresser vers le respect des limites planétaires.